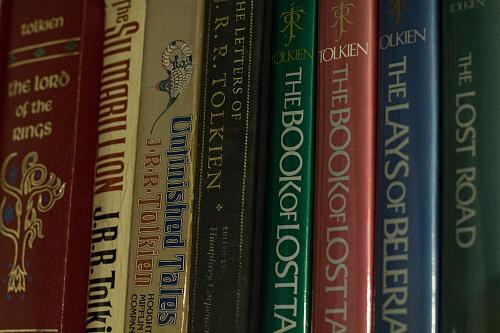Il a seize ans, mais son air fatigué lui en donnerait bien cinq de plus. Qui sait depuis combien de temps il n’a pas dormi dans un vrai lit ? Il est assis en deuxième classe dans le TGV pour Paris, son sac sur les genoux, les yeux tournés vers le sol. Le contrôleur arrive, il lui tend un billet qu’il n’a pas composté. Il ne savait pas. Il ne ment pas, son voyage est un aller simple. Le contrôleur s’emporte, réclame des papiers. Et voilà que le gamin se remet à faire son âge, que la peur se lit dans ses yeux. Il tend un acte de naissance rangé dans une pochette plastique. Le contrôleur néglige le document, lève les yeux au ciel et s’en va en maugréant.
« Tes papiers sont à la gendarmerie, va-t-en, sinon tu vas finir au centre de rétention »
À Paris, le gosse est attendu par un copain qui doit l’emmener au « DEMIE », le Dispositif d’évaluation des mineurs isolés étrangers, chargé de l’évaluation et de l’accueil des Mineurs non accompagnés à Paris. Il passe les entretiens, et par chance, il est reconnu mineur. Comme la loi l’autorise, afin de mieux répartir les mineurs sur l’ensemble du territoire, il est envoyé dans un autre département. Là-bas, il subit une seconde évaluation, qui conclut cette fois à sa majorité. Une toute jeune éducatrice vient le voir : « Tes papiers sont à la gendarmerie, va-t-en, sinon tu vas finir au centre de rétention. » Il erre sans but dans cette petite ville de province, parle avec les uns et les autres, parvient à se faire héberger par un homme qui n’est jamais chez lui mais qui lui fait confiance. Il passe ainsi quelques mois sans trop savoir que faire, puis un beau jour il s’en va, et disparaît. Un an plus tard, il laisse ces quelques mots sur un réseau social : « Celui qui ne renonce pas à son rêve finit par le vivre. » Il vient d’« être pris » dans un autre département. Il a désormais 17 ans.
Sans papiers comment est-ce possible ? « – Comment as-tu fait ? J’ai pris l’identité d’un ami mort au pays. – Et ta première identité c’était la vraie ? Oui, bien sûr. » Depuis lors, fatigué des patrons de restaurant qui ne paient pas son apprentissage, il a fait une formation dans la sécurité. « On chasse les migrants », explique-t-il, désabusé.

Cela fait sept ans que je côtoie ceux qu’on appelait des MIE, mineurs isolés étrangers, et qu’on nomme désormais des MNA, mineurs non accompagnés… la plupart ne le seront effectivement pas, ou mal, ou pas assez longtemps. Le premier avec lequel j’ai parlé était un Érythréen de 15 ans. Nous étions à Calais, il m’a montré de longues cicatrices sur ses jambes, et j’ai vu une colère immense dans ses yeux. « Why police beats us ? » « Pourquoi la police nous frappe-t-elle ? » répétait-il, parce qu’il croyait être arrivé au « pays des droits de l’Homme ». Cette formule, cette image, associée à la France, elle revient tout le temps. Et la police le sait, qui souvent est en charge d’accompagner les mineurs jusqu’au dispositif d’accueil. « Quand je suis arrivé, on m’a mis en garde à vue, je pleurais, alors un policier est passé et m’a dit, "pourquoi tu pleures, ici c’est les droits de l’homme, ici, y a pas la chicotte" » se souvient un autre adolescent qui a survécu à la prison en Libye.
« De toute façon tu es isolé, tu n’as pas besoin de contacts »
Un autre encore, dans une autre ville, rescapé d’un naufrage qui a emporté des dizaines d’hommes, de femmes et d’enfants, se fait doubler sur la droite par une patrouille, dont le chef l’accuse ensuite d’avoir franchi la ligne blanche. Il roule sur un vélo neuf premier prix, miraculeusement offert par le département. Les policiers lui demandent s’il l’a volé. Il montre l’antivol, donne le numéro de son éducatrice et s’en sort avec une contravention. À son arrivée à Paris, un an plus tôt, il a eu une autre amende, à cause cette fois d’un éducateur pressé qui lui a dit de sauter le portique du métro : « Ne la paie pas, ils oublieront ! » Mais les relances se sont succédé au service de l’aide à l’enfance du département où il a été transféré, lequel au bout d’un an a fini par les transmettre à l’intéressé, avec l’injonction de payer désormais quelque trois cents euros…
Un autre jour, le responsable local des services sociaux m’appelle pour « m’apprendre » que ce même jeune, par ailleurs élève modèle aujourd’hui étudiant en Master, est en garde à vue à 30 kilomètres de la ville où il réside. Il se trouve que je suis venu lui rendre visite, et nous nous regardons interloqués, tandis que le chef de service s’interroge sur ses méfaits imaginaires. Quelques minutes plus tard, le chef de service me rappelle : « Je me suis trompé, il s’agit d’un homonyme mineur, qui ne sachant pas où aller, s’est rendu au commissariat. » Cet homonyme, je le rencontrerai aussi, après l’avoir cherché en vain sous la pluie un soir vers Stalingrad, parmi des centaines d’autres migrants. L’association en charge de l’accueillir a contesté sa minorité, mais elle sait qu’il a été repéré par une autre association de bénévoles, alors on lui rend son portable mais pas la carte SIM : « De toute façon tu es isolé, tu n’as pas besoin de contacts. »
Tests osseux : aucune des méthodes utilisées n’a été remise à jour depuis plus d’un demi-siècle
Je pourrais continuer ainsi longtemps à égrener les injustices dont sont victimes ces mineurs à qui la France, en vertu de la Convention internationale des droits de l’enfant, doit assistance et protection jusqu’au jour de leur majorité. Face à un flux plus important durant l’année 2015, les structures en charge d’accueillir les jeunes dans les départements, mais aussi l’Éducation nationale, la Justice ou la Police aux frontières ont œuvré chacune à leur manière pour juguler la brusque montée des effectifs.
Ainsi, à Paris notamment, les évaluations sont-elles devenues de plus en plus fantaisistes, quand certains n’ont pas été purement et simplement refoulés au guichet. C’est une manière commode d’écarter une part du public des statistiques et jusqu’à une période récente, de la possibilité même de faire recours, puisqu’il n’y a aucune trace du refus de prise en charge. Devant la multiplication des cas, les juges ont fini par accepter de contester des décisions qui, matériellement, n’ont jamais été prises.
Pour la mise à l’abri temporaire avant l’évaluation, rendez-vous est donné aux primo-arrivants à l’autre bout de la ville. Le référent s’y rend généralement avec beaucoup de retard. Celles et ceux qui n’auront pas trouvé l’endroit ou se seront découragés entre temps seront autant de cas de moins à traiter. Concernant les papiers, chaque année voit de nouvelles raisons de remettre en cause leur validité, on cherche la rature ou l’erreur avec obstination.
Pour les Guinéens, par exemple, particulièrement nombreux, on invoque une date écrite en chiffres et non en lettres, ou encore un délai non respecté entre l’acte de naissance et le jugement supplétif qui atteste que le premier document n’a pas été contesté. Il faudra une déclaration officielle d’un juge guinéen expliquant que cette loi n’est pas appliquée pour que ce subterfuge soit peu à peu abandonné.
Viennent ensuite les tests osseux, qu’Éric Ciotti (député LR) a dit tout récemment vouloir rétablir alors même qu’ils sont toujours largement pratiqués. Ils ont servi par exemple à ce qu’un jeune Ivoirien à Lyon, pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance à l’âge de quinze ans, soit accusé d’avoir maquillé son identité puisque les tests osseux lui donneraient un âge moyen de… 29 ans – avec un minimum de 15, 17 ou 21 ans. Aucune des méthodes utilisées n’a été remise à jour depuis plus d’un demi-siècle et elles se réfèrent à des populations très différentes de celles actuellement testées sur notre territoire. Peu importe que le jeune en question suive une scolarité exemplaire et n’ait jamais quitté le foyer où on l’avait placé – ce qu’aurait sans doute fait un homme de 29 ans au milieu d’adolescents de 15 ans. En deux ans, il est passé pas moins de cinq fois devant la justice où il risque une condamnation au pénal. En appel, la décision est attendue pour le 29 octobre.
Une machine à briser des enfants et leurs rêves
Depuis 2015, la proportion des jeunes de plus de 16 ans pris en charge mais non scolarisés – la scolarisation n’étant obligatoire que jusqu’à 16 ans – a largement augmenté, malgré le souhait de la plupart d’entre eux, qui associent la formation à la possibilité de trouver un travail. Dans de nombreux départements, les filières proposées ne sont désormais plus que des CAP en alternance. Cela permet d’atteindre deux objectifs : alléger au maximum le coût de la formation et se libérer des jeunes au plus vite dès leur 18 ans.

En privé, éducateurs et professionnels des CASNAV (Centre Académique pour la Scolarisation des élèves allophones) se montrent très critiques : l’alternance n’est pas adaptée à des jeunes « NSA-PSA » (non ou peu scolarisés antérieurement, selon les sigles de l’Éducation nationale), parce qu’on n’acquiert pas les bases en étudiant une semaine sur deux ou trois. Par ailleurs, des secteurs entiers dits en tension – autrement dit des métiers dont ne veulent pas les Français – sont occupés par ces jeunes, dont les patrons vantent la docilité. À tel point qu’ils n’hésitent souvent pas à les remplacer par d’autres tout aussi dociles dès la fin de leur contrat d’apprentissage.
Le jeune majeur se retrouve ainsi sans métier et parfois sans diplôme (s’il n’a pu consolider à temps son niveau scolaire) partant sans papiers et expulsable, mais bien plus opportunément exploitable par des secteurs connus pour un usage massif de main d’œuvre non déclarée (bâtiment, restauration, aide à la personne etc.). Ici comme ailleurs, il est courant que lors des entretiens (je me base sur une cinquantaine d’échanges réalisés au fil des ans), professionnels de l’Éducation nationale et éducateurs finissent par valider une fiction démentie par les faits pour ne pas désespérer complètement d’une machine à briser des enfants et leurs rêves.
Ainsi, si 80 % des jeunes qui sont enregistrés par le DEMIE ne sont pas reconnus mineurs (chiffres de 2016, provenant d’une circulaire interne), c’est qu’ils ne le sont pas, entend-on dire souvent. Or, une majorité d’entre elles et d’entre eux finira par obtenir gain de cause après une série de recours pouvant durer jusqu’à un an et demi. Combien ai-je vu passer de ces jeunes déboutés, dont certains n’avaient que quatorze ou quinze ans et faisaient parfaitement leur âge ! Parfois aussi, mais beaucoup plus rarement, il m’est arrivé de douter de l’âge allégué. Les mêmes éducateurs, du reste, ne manquent pas de souligner ce qui motivent les tentatives de fraude : si de jeunes majeurs tentent de se faire passer pour des mineurs – ce qui arrive, mais peu y parviennent – c’est essentiellement parce que c’est pour eux le seul moyen de légaliser leur présence en France avec une demande d’asile.
Les suicides de mineurs non accompagnés se sont multipliés
Une autre légende tenace vaudrait que les jeunes soient envoyés désormais en CAP car, sauf exception, ils ont un niveau scolaire faible ou inexistant. Parmi celles et ceux que j’ai pu suivre depuis 2015, et qui ont été soutenus ou accompagnés pour la plupart par des associations et des bénévoles en plus du cadre officiel, une moitié étudie ou a étudié jusqu’au BTS, quelques uns sont entrés à l’Université, un en médecine, lequel avait été initialement orienté vers un bac professionnel, pour devenir aide-soignant. Certains pourront conclure que je suis marqué par la chance, laquelle m’aura suivi dans trois ou quatre départements. Il est vrai que jusqu’à une période récente, les bons élèves pouvaient bénéficier jusqu’à leur 21 ans d’un contrat jeune majeur, leur permettant de pousser un peu leurs études.
Au fil des ans, donc, il s’est recréé quelque chose qui ressemble de plus en plus à un rapport racial, avec ou sans chicotte, qui rappelle à s’y méprendre celui de la colonisation : le migrant, comme le colonisé, est traité avec défiance, soupçonné d’être hâbleur et menteur, en l’occurrence ici sur son âge et son parcours. Il n’est pas exclu, j’en ai donné un exemple, qu’il finisse pas se conformer à cette image pour faire sa place parmi nous. Il a parcouru en moyenne 6000 kilomètres, a vu dans la majorité des cas des camarades mourir. Il en a laissé beaucoup d’autres derrière lui, qui n’ont pas réussi à passer. Il n’est effectivement plus à cela près.
Peu importe si les études montrent que les migrants arrivant en France ont un niveau scolaire moyen supérieur à celui des Français, le mineur non accompagné est supposé inculte, et il comprend très vite qu’il doit accepter ce qu’on lui propose (généralement des métiers où ses collègues seront noirs ou d’origine maghrébine en majorité) sous peine de se voir délivrer une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. « Tu pourras toujours reprendre tes études plus tard » lui dira l’éducateur qui cherche à se rassurer.
Dans ce tableau si sombre, la dignité et le courage des bénévoles et de nombre de professionnels imposent le respect
« Ce qui est surprenant, témoigne une permanencière de l’Association de défense des jeunes isolés étrangers (ADJIE), ce n’est pas que parfois l’un d’eux décompense, comme on dit, c’est que ça n’arrive pas plus souvent. » Cette violence subie, institutionnelle bien sûr, mais aussi celle de la rue, car beaucoup y restent des semaines avant d’être pris en charge par des bénévoles, en mène certains au suicide. On se souvient bien sûr de Denko Sissoko, un adolescent malien qui s’est jeté du huitième étage du dispositif d’hébergement à Châlons-en-Champagne. Son histoire avait ému la presse, mais elle a été suivie par tellement d’autres depuis qu’on ne prend plus la peine de s’y arrêter.

Une bénévole des Midis des MIE, qui s’occupe d’orienter et de soutenir les gamins renvoyés à la rue à Paris, évoque le cas de Kassim, un garçon fragile, qu’elle a hébergé et qui s’est suicidé à Lorient, peu après avoir été chassé de son hôtel, le jour de ses 18 ans : « J’avais tellement l’impression d’être dans sa tête, de sentir ce qu’il avait dû sentir, d’isolement, de solitude, d’abandon. Qui a envie de faire ça ? De partir de chez soi à l’âge de quinze ans ? » Au téléphone, le commentaire reste sobre, posé, sans pathos. Dans ce tableau si sombre, la dignité et le courage des bénévoles et de nombre de professionnels imposent le respect.
Malheureusement, beaucoup de celles et ceux qui ont rejoint la mobilisation après 2015 ont dû reprendre leurs distances : « J’ai craqué quand après quelques mois j’ai dû demander à un jeune de prendre le sac de couchage que je lui tendais et de retourner à la rue, parce que je n’avais plus aucun hébergement à lui proposer », m’a confié une autre bénévole qui depuis a repris le cours d’une vie « normale ». Des jeunes, il en vient pourtant toujours, même si le confinement a tari momentanément « le flux » et que les chiffres sont en légère baisse depuis 2019. Cet été, un campement a été monté en plein cœur de Paris pour sensibiliser population et autorités au fait que beaucoup de jeunes n’avaient ni prise en charge ni logement.
L’indifférence et la haine
Beaucoup de jeunes ont témoigné sur ce qu’ils avaient enduré avant, pendant et après leur voyage, sur la force de leurs rêves et leur stupéfiante capacité de résilience. Des livres comme celui de Rozenn le Berre, des films comme ceux de Rachid Oujdi ou d’Aferdite Ibrahimaj [1] , ont largement documenté la réalité de ces parcours, mais la machine à fantasme a repris de plus bel ces derniers mois.
La première raison en est l’existence d’un nouveau profil de jeunes, venus du Maghreb, vivant de petite délinquance et souffrant de lourdes addictions. Un éducateur de banlieue parisienne explique que dans son centre ils représentent désormais un tiers des jeunes accueillis : « Beaucoup sont très abîmés et relèvent de la psychiatrie. » Les autres associations, militantes ou institutionnelles, n’y sont guère confrontées, car ces jeunes-là ne sont pas demandeurs d’aide. « On les voit parfois demander des vêtements ou de la nourriture explique la bénévole des Midis des MIE, mais ils ne veulent pas de prise en charge. » Cette présence difficilement quantifiable est du reste limitée à quelques grandes métropoles, Paris en tête. Sur elle, pourtant, les articles sont légion, permettant d’alimenter à souhait la confusion tant désirée entre Mineurs non accompagnés et délinquance.
La double agression par un jeune Pakistanais rue Nicolas Appert le 25 septembre dernier a fait naître quant à elle une campagne médiatique et idéologique d’une violence sans précédent contre les mineurs non accompagnés. À la différence de « l’attaque de la mosquée de Bayonne » [2] qui avait fait elle aussi deux blessés graves mais a été aussitôt décrite comme un acte isolé, « l’attaque du 25 septembre 2020 » à Paris a été immédiatement qualifiée d’« acte de terrorisme islamiste » par le ministre de l’intérieur, alors même que l’agresseur a, semble-t-il, agi isolément, au point qu’il n’était pas même au courant du déménagement des locaux de Charlie Hebdo depuis le 8 janvier 2015.
Lors de l’attaque de la mosquée de Bayonne, un avocat avait rappelé que « l’attentat revêt une dimension politique ou idéologique, qui peut difficilement être retenue quand il s’agit de l’acte d’un déséquilibré ». On rappellera néanmoins que le tireur, décédé depuis, avait été perçu comme suffisamment sain d’esprit quelques années plus tôt pour être choisi comme candidat local du Front national et qu’il était familier des appels à la violence. Quoi qu’il en soit le cas du jeune agresseur de la rue Nicolas Appert n’a bénéficié en comparaison d’aucune forme de réserve ou de doute sur sa responsabilité pénale.
« J’en ai rien à foutre » a répondu un jour une juge des enfants à un mineur
Bien plus grave cependant est le véritable tempête d’articles faisant de ce fait divers le révélateur de la nature délinquante des mineur.es non accompagné.es. Le crescendo déjà nauséabond des jours précédents a trouvé son acmé dans les propos d’Éric Zemmour sur Cnews ce 29 septembre, dont voici un court extrait : « Ce Pakistanais est l’archétype de ce qu’on appelle un Mineur isolé étranger. (…) Ils n’ont rien à faire ici, ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c’est tout ce qu’ils sont. Il faut les renvoyer, attendez il ne faut même pas qu’ils viennent, et (..) pour cela il faut sortir de la Convention européenne des droits de l’homme, qui, je vous le rappelle, est l’origine du mal, c’est la Cour européenne des Droits de l’Homme et la Convention des Droits de l’Enfant qui nous obligent à n’expulser personne. »
Aussi immondes soient-ils, ces propos ne sont que l’expression débridée d’une hostilité croissante de l’administration et de l’indifférence globale de la population française, laquelle se montre bien plus hostile aux migrants en général que ses voisins allemands, belges ou espagnols par exemple. Les manifestations parisiennes pour ces causes n’ont jamais mobilisé plus de quelques milliers de personnes, depuis bien des années.
« J’en ai rien à foutre » a répondu un jour une juge des enfants à un mineur la suppliant de lui donner accès à un hôtel, car il avait honte d’être hébergé depuis des mois par des particuliers. L’adolescent l’a revue quelques mois plus tard dans une vidéo diffusée en classe, où elle vantait les beautés de son métier. Entre temps, on lui aura sans doute expliqué à la télévision qu’ « il n’y a pas de racisme systémique en France. »
Olivier Favier
Photo de une : Des adolescents érythréens. Celui de gauche a été battu par la police la veille au soir. Calais, juillet 2014 / © Olivier Favier