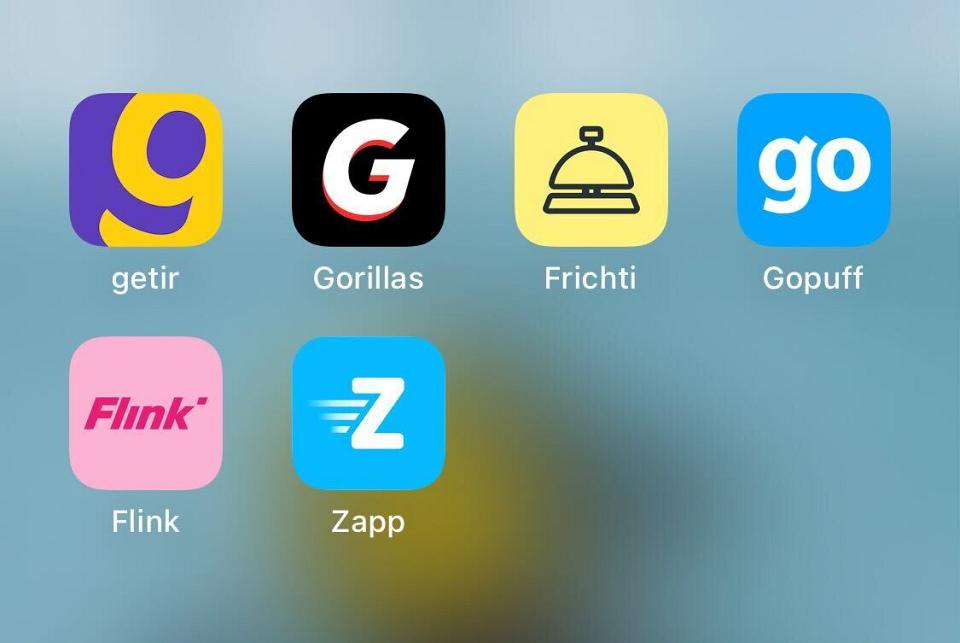
« Une trahison. » Les anciens élus du personnel de Gorillas se souviennent du 21 juin dernier comme si c’était hier. Ce jour-là, Getir, le propriétaire de la plateforme de livraison de courses à domicile, annonce se retirer du marché français. Après des semaines à essayer de redresser l’entreprise, personne ne comprend.
La société turque Getir était propriétaire des entreprises de livraison Gorillas et Frichti, tout en proposant un service de livraison à son nom. Leur chute a été aussi brutale que leur arrivée sur le marché français. En 2021, ces entreprises promettaient des milliers d’emplois créés, des courses livrées en une dizaine de minutes, des promotions à n’en pas finir et des travailleurs salariés et pas indépendants… Et puis, plus rien. Gorillas et Getir n’auront tenu que deux ans en France. Deux ans d’un capitalisme agressif qui, à la fin, laisse des milliers de travailleurs sur le carreau.
« À notre arrivée, on y croyait »
« L’annonce de l’arrêt de Getir en France a été perçue comme une trahison... Parce qu’on avait fait beaucoup d’efforts pour que l’entreprise puisse continuer », explique Arnaud Coulibaly, délégué syndical CGT et ancien représentant des salariés de la plateforme. À ses côtés, Ibrahima Cissokho et Souleymane Bamba étaient eux aussi des représentants du personnel. Ils ont tous trois commencé en même temps dans l’entreprise, en avril 2021, comme « riders » (coursiers) rattachés à l’entrepôt du quartier de Bastille, à Paris.
« On a commencé à travailler sans même avoir de contrats. On venait de sortir du Covid. À notre arrivée, on y croyait. On s’est dit que cette idée pouvait améliorer le quotidien des gens, se remémore Souleymane Bamba, qui est ensuite devenu délégué et élu suppléant du personnel. Même si on n’a pas tout de suite eu de contrat de travail, on s’est dit “on va y aller, ce n’est pas grave”. On a protégé l’employeur. On s’est dit que c’est un gros business, que tout n’était pas carré tout de suite, mais qu’on allait mettre les choses en place. »
« Au début, on avait plein d’avantages pour les salariés », se rappelle Arnaud Coulibaly. Boissons chaudes à disposition, nourriture… Les travailleurs, dont certains étaient sans-papiers, s’investissent corps et âme dans un projet dont on leur promet qu’ils seront moteurs. Après les premières difficultés financières de l’entreprise, ils racontent s’être « sacrifiés » pour aider Gorillas à s’en sortir. « Vu qu’on se disait qu’on avait perdu assez d’argent, on essayait de se passer de nos avantages. Il y a des salariés qui ont fait des heures supplémentaires non déclarées, qui restaient toujours disponibles pour travailler. C’était épuisant », explique Arnaud Coulibaly.
Pression constante
Gorillas se retrouve rapidement en difficulté financière. L’entreprise perd de l’argent et essaye de montrer malgré tout aux investisseurs qu’elle peut être rentable. Début 2022 naît alors l’idée du « Decabreak », une opération menée dans quelques entrepôts. « Le but était de montrer qu’un seul magasin avec un effectif réduit pouvait être plus rentable que les autres », explique le représentant CGT Arnaud Coulibaly. Il se rappelle devoir alors réaliser, avec ses collègues, entre 500 et 600 commandes par jour, engrangées par des codes promo alléchants pour les consommateurs.
La réalité est moins enthousiasmante, racontent les ex-salariés parisiens. « Ils ont voulu faire croire aux actionnaires qui sont majoritairement basés en Allemagne que ça allait. L’opération a permis de faire une levée de fond. » Pourtant, les effectifs communiqués ne collent pas à la réalité dans les entrepôts. « On déclarait qu’on était sept sur la journée, mais en réalité, on était 17 ou 18. On savait que la suivie de la boîte en dépendait. »

D’un large geste, Souleymane Bamba englobe la grande table devant lui : « Tout ça, c’était rempli de commandes. » Riders, superviseurs et managers subissent une pression constante.« On tirait vraiment sur la corde. On a fait un sacrifice considérable, surtout à l’entrepôt de Bastille », se rappelle Ibrahima Cissokho.
En parallèle, l’entreprise loue à prix d’or des locaux qu’elle finit par ne pas utiliser. « On a même pris un entrepôt rue de Rivoli qui coûtait une blinde, et qui n’a jamais été exploité. On y a entreposé des vélos après », se remémore Souleymane Bamba. Pendant que les employés trimaient dans les entrepôts, « ils brûlaient du cash », dit-il au sujet de la direction.
Placardisation et souffrance
Un mois après cette opération, Gorillas rachète la start-up Frichti. « Le rachat a amené beaucoup de tensions », se rappelle Souleymane Bamba. Il travaillait au siège de l’entreprise à ce moment-là. La direction parle alors de mutualisation, Gorillas veut remplacer ses managers par ceux de Frichti. « Il y a eu des tensions au siège parce qu’il y avait des personnes qui avaient plus de diplômes que les employés de chez Frichti qui devenaient leurs supérieurs », raconte-t-il.
Les salariés de Gorillas ne sont pourtant pas licenciés.« Arrivé à un moment, on n’avait plus de missions, j’ai été mis au placard, rapporte aussi Souleymane Bamba. Je n’aurais jamais cru pouvoir être atteint psychologiquement à un moment donné de ma vie. J’ai vécu ça chez Gorillas. » Face aux tensions croissantes, le projet de mutualisation est abandonné. La souffrance au travail, elle, continue.
« Vous savez, en tant que personne en situation irrégulière en France, je tenais à mon travail, dit Souleymane Bamba. Si quelqu’un qui est sans-papiers vous dit aujourd’hui qu’il était soulagé de quitter une boîte, imaginez ce qu’il a subi. »
En décembre 2022, Gorillas – et donc Frichti – est racheté par l’entreprise turque Getir. Dès cette annonce, les syndicats et élus anticipent de potentielles suppressions d’emplois et essayent de négocier les conditions d’un plan social. Mais les salariés ne reçoivent aucune information sur la suite, ni pendant cette période ni lorsque Getir, Gorillas et Frichti sont placés en redressement judiciaire le 2 mai 2023.

Ibrahima Cissokho ne travaille alors déjà plus dans les entrepôts, mais il s’y rend régulièrement en qualité d’élu du personnel. Chaque visite est une souffrance, dit-il. Il est assailli de questions des travailleurs qu’il représente.« On pense que les réponses qu’on nous donne en comité social et économique (CSE) sont vraies, mais après, ils font des choses différentes, témoigne-t-il. On a fait croire aux gens que tout allait bien se passer, qu’on aurait un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), qu’ils allaient avoir de l’argent… » La vérité, c’est que même les élus ne savent pas ce qu’il adviendra de Gorillas. « Dans les yeux de mes collègues, je voyais que ça n’allait pas. J’ai eu des messages où les gens craquaient. Nous, on devait encaisser », poursuit Ibrahima Cissokho.
« Je pensais que les problèmes psychologiques, c’était pour les blancs, sourit timidement l’ancien élu du personnel, déclenchant un rire chez ses collègues. Un jour, j’ai dit à Rémy [Frey, de la CGT Commerce qui a accompagné les salariés de Gorillas, ndlr], “Là, c’est trop, je commence à craquer”. Ça ne m’était jamais arrivé dans ma vie. »
« Tous ces sacrifices… Ça a été vain »
Au beau milieu du mois de juin et de la procédure de redressement judiciaire, l’actionnaire Getir annonce se retirer du marché français. Il décide de ne plus financer sa filiale française. Quelques jours avant de négocier le PSE, les salariés des trois entités comprennent alors que la discussion n’aura pas lieu. Getir justifie alors dans un communiqué son départ par « l’environnement juridique complexe » et « les réglementations imposées par les administrations locales ».
Ibrahima Cissokho voit les choses autrement. « Les fonds dans les caisses ne suffisaient pas, et l’actionnaire principal n’a pas voulu engager d’argent, analyse-t-il. Tout ce travail, tous ces sacrifices… Ça a été vain. Gorillas a voulu faire croire aux gens qu’ils étaient là pour créer de l’emploi, permettre aux jeunes de travailler, diminuer le chômage… Mais en réalité c’est un système qui était voué à se fracasser face à la réalité. C’est ce qu’il s’est passé », ajoute-t-il.
Désormais, les trois ex-employés de Gorillas cherchent un nouveau travail. « Mais pas dans la livraison, plus jamais ! », affirment en cœur Ibrahima Cissokho et Souleymane Bamba. Le dernier ajoute qu’il souhaite juste travailler dans quelque chose d’utile pour la société. Peut-être en rapport avec les vélos, parce que « c’est l’avenir de Paris », sourit-il. Avant de repartir, Ibrahima Cissokho se retourne et pose une dernière question.« Maintenant, la seule interrogation, c’est : comment faire pour que ça ne se reproduise plus ? »
Lire les deux autres volets de notre série :
– Vie et mort du quick commerce en France : des années de non-respect de la loi
– Face à la dégringolade des livraisons de courses, les travailleurs des plateformes résistent
Emma Bougerol
Photo de une : Ibrahima Cissokho (à gauche) et Arnaud Coulibaly (à droite), devant l’ancien entrepôt de Gorillas près de Barbès, rue Belhomme, dans le 18e arrondissement de Paris. © Yann Lévy








