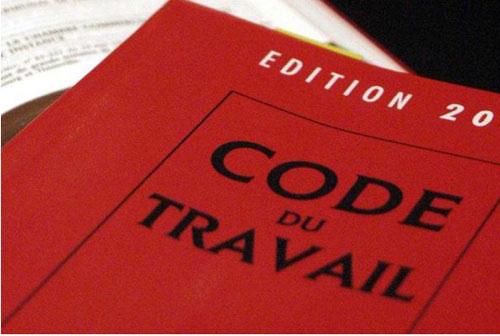L’accord national interprofessionnel, conclu le 11 janvier, cela vous dit quelque chose ? Signé par le Medef et trois organisations syndicales (CFDT, CFE-CGC, CFTC), il est censé apporter « plus de souplesse pour les entreprises et plus de protection pour les salariés ». Ses dispositions doivent désormais être inscrites dans la loi. Il a été qualifié de compromis « historique » dans plusieurs médias. S’il est retranscrit tel quel par les parlementaires, cet accord pourra effectivement être qualifié d’ « historique ». Historique, dans le sens où il marquera une régression sociale jamais égalée depuis un demi-siècle. En particulier dans l’assouplissement des procédures de licenciements [1].
Jusqu’à présent, pour vous licencier, un employeur doit justifier d’une « cause réelle et sérieuse ». Soit cette cause est liée au salarié – mesure disciplinaire s’il a commis une faute, raison médicale, insuffisance professionnelle… – et c’est un licenciement pour motif personnel. Soit elle est indépendante du salarié en tant que personne mais liée à la situation économique de l’entreprise : modification du contrat de travail, suppression d’emplois, difficultés économiques, mutation technologique, restructuration, cessation d’activité… Et c’est un licenciement économique. Dans tous les cas, la « cause réelle et sérieuse » doit être attestée par l’employeur et peut être contestée par le salarié, ou les organisations syndicales. Seule exception, depuis 2008, la « rupture conventionnelle », consentie, en théorie, entre les deux parties.
Si l’entreprise procède à plus de dix licenciements économiques, elle doit mettre en œuvre un « Plan de sauvegarde de l’emploi » (PSE). Un PSE oblige l’employeur à consulter le Comité d’entreprise, qui peut recourir à une expertise indépendante pour vérifier la réalité et le sérieux du motif économique. Il doit également chercher à reclasser les salariés concernés ou leur proposer des formations. En cas d’échec des négociations, les représentants du personnel peuvent saisir la justice qui aura à se prononcer sur la validité du PSE. Tout cela risque de profondément changer. Avec l’accord du 11 janvier, l’employeur n’aura plus, dans bien des cas, à justifier d’une « cause réelle et sérieuse » pour vous licencier, ni à mettre en œuvre un plan social.
Licenciement automatique
Comment un patron pourra-t-il s’y prendre ? Première option : proposer un « accord de maintien dans l’emploi » (sic), s’il estime que son entreprise traverse de « graves difficultés conjoncturelles ». Une industrie automobile dont les ventes chutent, un prestataire de services dont le chiffre d’affaires trimestriel marque le pas, une PME dont le carnet de commande ne se remplit pas. Un tel accord consiste à tout faire pour maintenir les effectifs en échange d’un aménagement du temps de travail et du salaire. Un « effort » d’une durée maximale de deux ans. Imaginez donc qu’en raison de « graves difficultés conjoncturelles », votre entreprise propose de ne licencier personne, à condition que chacun passe de 35h hebdomadaires à 39h, sans augmentation de salaire. Ou qu’au contraire, on vous demande de ne travailler que 28h avec une baisse de salaire conséquente.
Imaginez ensuite que le ou les syndicats majoritaires au sein de l’entreprise signent cet accord au nom de la préservation de l’emploi. Pour être valide, il doit être signé par des organisations représentant au moins 50 % des votants lors des précédentes élections professionnelles au sein de l’entreprise. Imaginez enfin que vous refusiez cette hausse du temps de travail sans compensation ou une baisse de salaire. Et bien ce sera la porte, sans contestation possible ! Car une fois validé, cet accord « s’impose » à votre contrat de travail, même s’il « requiert néanmoins l’accord individuel du salarié ». Un désaccord implique un licenciement automatique.
La fin des recours en justice ?
Pire : si vous êtes plus de dix salariés dans ce cas, il n’y aura pas pour autant de plan social. Donc aucune des obligations qui l’accompagnent : pas de consultation des institutions représentatives du personnel, pas de reclassement, pas d’aide à la formation, pas d’indemnités particulières… Même si plusieurs centaines de salariés sont invités à prendre la porte. Car leur licenciement « s’analyse » bien comme un licenciement économique mais n’est encadré par aucune de ses règles. « L’entreprise est exonérée de l’ensemble des obligations légales et conventionnelles qui auraient résulté d’un licenciement collectif pour motif économique », précise l’article 18 de l’accord [2].

Et ce n’est pas tout : il vous vient à l’idée de contester devant les tribunaux ce licenciement comme étant abusif, dont peut-être « la cause réelle et sérieuse » n’est pas avérée. Peine perdue. « L’accord de maintien dans l’emploi », qui « s’impose » à votre contrat de travail, atteste de « la cause réelle et sérieuse » des licenciements. « Cela signifie une rupture immédiate du contrat de travail, avec de grandes difficultés pour contester la cause du licenciement. Vous fermez l’action judiciaire à un salarié », commente la juriste Marie-Laure Morin, ancienne conseillère à la Cour de cassation.
« Dès lors qu’un tel accord sera signé, l’employeur sera dégagé de toute obligation. Et évite tout contrôle par le juge de la réalité et du sérieux du motif économique. C’est un recul énorme ! Un boulevard pour procéder à des licenciements ! », ajoute Jean-François Lacouture, conseiller prud’hommes (collège salarié) et syndiqué CGT. Pour lui, ces licenciements « économiques », sans qu’on puisse interroger la réalité de leur motif, marquent un retour de quarante ans en arrière. Avant 1973, l’employeur n’était pas obligé de motiver un licenciement.
Trois conventions internationales foulées du pied
L’article 18 est en violation d’au moins trois conventions européennes et internationales. Celle de l’Organisation internationale du travail (OIT), sur le licenciement, entrée en vigueur en 1985 [3], la Charte sociale européenne [4] ou la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui précise que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement » [5].
Un problème de taille qui ne semble pas émouvoir la CFDT, le principal syndicat qui a paraphé le texte aux côtés du Medef. Ces accords de maintien dans l’emploi « ne pourront en aucun cas déroger aux éléments d’ordre public, comme le Smic ou les 35 heures », positive la confédération... Encore heureux ! Quant aux députés socialistes, qui seront amenés à se prononcer à l’Assemblée nationale sur la transcription de l’accord dans la loi, ils ne semblent pas y déceler d’inconvénients : « Il s’agit de mieux anticiper les difficultés conjoncturelles. Aujourd’hui, beaucoup d’entreprises optent trop facilement pour le licenciement en cas de difficultés. Cet accord inverse la tendance en faisant du licenciement la dernière option. », explique leur texte répondant aux critiques sur l’accord. Ont-ils vraiment lu le même document ?
Mobilité forcée
Il n’y a malheureusement pas que l’accord de « maintien dans l’emploi ». Une seconde option alléchante s’ouvre à tout employeur qui aurait envie de dégraisser à moindre frais, sans contrôle et en toute légalité. C’est l’article 15 qui permet aux directions d’entreprise d’imposer, de fait, une « mobilité interne » à leurs subordonnés. Exemple ? Une usine de production située à Valence, ou un centre d’appels installé dans la banlieue de Lille, décide de transférer son activité en région parisienne, dans le cadre d’une réorganisation, sans motif économique particulier.
Aujourd’hui, cette délocalisation implique une modification de votre contrat de travail – sauf si ce contrat prévoit spécifiquement une « clause de mobilité » (dans ce cas le salarié a consenti à être mobile). Sans cette clause, si le salarié refuse et que l’employeur décide de le licencier, il est confronté à un flou juridique : ce n’est ni un licenciement pour motif personnel, ni pour motif économique. L’employeur s’expose donc à une condamnation judiciaire s’il ne négocie pas de compensations suffisantes à cette délocalisation et aux départs qu’elle occasionne.

L’article 15 de l’accord vise à combler ce flou. Mais d’une manière totalement déséquilibrée pour les salariés. Les mobilités internes constituent une réorganisation « ne comportant pas de réduction d’effectifs », mais se traduisant « par des changements de poste ou de lieux de travail ». On déplace une activité d’un département à un autre, tout en changeant le poste d’une partie des employés transférés, sans diminuer leur niveau de rémunération. Ces mobilités seront négociées tous les trois ans. Direction et représentants du personnel y définiront « les limites imposées à cette mobilité au-delà de la zone géographique de son emploi ». Donc au-delà du bassin d’emploi – une agglomération par exemple – au sein duquel vous travaillez.
Malgré d’éventuelles « dispositions visant à prendre en compte la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale », ces négociations, et l’accord qui en découlera, pourront donc vous obliger à traverser la France en cas de réorganisation au sein de l’entreprise, du regroupement d’un service ou du transfert d’un atelier de production [6]. « Actuellement, le lieu du travail et le poste du travail étaient considérés comme parties intégrantes du contrat du travail. Dorénavant la mobilité interne peut être organisée sans bornes si un accord d’entreprise la stipule », explique Eric Beynel, porte-parole de l’Union syndicale Solidaires [7]. Un tel accord sera valide s’il est cosigné par un ou plusieurs syndicats représentant au moins 30 % des voix aux élections professionnelles.
Un licenciement économique pour motif personnel
Peugeot souhaite fermer son usine d’Aulnay et transférer ouvriers et techniciens à Rennes ? Free veut regrouper tous ces services clientèle en Lorraine ? La Fnac veut fermer son magasin de Châteauroux et transférer ses vendeurs à Poitiers ? Pas de problème ! Mais que se passera-t-il pour le salarié qui refuse ? Cela « n’entraîne pas son licenciement pour motif économique. Il s’agit d’un licenciement pour motif personnel ouvrant droit à des mesures de reclassement telles qu’un bilan de compétence ou un abondement du compte personnel de formation », répond l’accord. C’est un changement fondamental du droit du travail : l’invention d’un licenciement pour motif personnel alors que la cause du licenciement n’est pas liée au comportement du salarié mais à une réorganisation de son entreprise, justifiée ou pas. [8]
« Il est probablement absurde d’utiliser aujourd’hui la procédure de licenciement économique pour des réorganisations. Mais là, c’est clairement un chantage à l’emploi : soit on accepte, soit on dégage », réagit la juriste Marie-Laure Morin. Exit la possibilité pour le salarié de refuser le nouveau poste s’il ne veut pas aller pointer au chômage. Et là aussi, si des dizaines de salariés refusent la mobilité interne, il n’y aura pas de plan social puisqu’il s’agira de licenciements pour motif personnel. « Quand, aujourd’hui, une entreprise supprime tel pôle d’activité et que plus de dix salariés refusent leur mutation, les procédures normales sont appliquées : consultation du comité d’entreprise, négociations, possibilité de recourir à une expertise pour analyser les conséquences de la réorganisation, possibilité pour le salarié de refuser sa mutation. Toutes ces garanties sont supprimées », pointe la juriste.
Harcèlement organisationnel légalisé
On a du mal à imaginer les dégâts qu’un tel accord pourrait provoquer. L’exemple de la brutale restructuration qu’a connu le groupe France Télécom – Orange, entre 2005 et 2010, peut en partie l’illustrer : des dizaines de milliers de suppressions de postes, de regroupements de services, de mutations, de changements de métiers… Et ce, sans aucun plan social car les salariés concernés gardaient, en grande majorité, leur statut de fonctionnaire. Devoir d’obéissance et culture administrative obligent, ils n’avaient pas vraiment d’autres choix que de s’y résigner, à part démissionner. On sait sur quels drames cela a débouché : stress et mal être généralisés, inflation de dépressions, jusqu’à la crise des suicides. Avec cet accord, tout salarié d’un grand groupe pourra subir le même sort, en toute légalité, et sans que leur direction soit poursuivie [9]. L’article 15 risque bien de légaliser le harcèlement organisationnel.

« Il s’agit probablement d’une des mesures les plus dangereuses de cet accord », estime la CGT. « Des pratiques interdites, comme les licenciements boursiers, peuvent être réalisées en toute impunité avec ce type d’accord. Qu’est-ce qui empêchera un employeur de proposer, à des salariés, des modifications de lieu de travail ou de poste, proprement inacceptables et de les licencier en masse pour motif personnel, donc sans les garanties propres aux licenciements économiques collectifs ? » De son côté, la CFDT n’y voit rien à redire : « Cela ne pourra se faire que si aucun emploi n’est menacé. L’employeur sera tenu de maintenir salaire et qualification », défend-elle. Du côté des employeurs de l’économie sociale (USGERES [10]), concurrent du Medef lors des élections patronales, on « souligne le caractère historique de cet accord qui permet de concilier des objectifs de flexibilité pour les employeurs, d’une part, et la sécurisation du parcours pour les salariés, d’autre part ». De la part de l’économie sociale, on aurait pu s’attendre à un discours un peu plus nuancé.
La fin du contrat de travail ?
L’accord de « maintien dans l’emploi » comme celui sur la « mobilité interne », en s’imposant de fait aux salariés, marquent-ils la fin du contrat de travail comme référence ultime ? « Lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables », dit le Code du travail [11]. Aujourd’hui, la loi fixe un cadre minimum à respecter : salaire minimum, temps de travail maximum, congés payés minimum… Viennent ensuite les accords de branche (assurance, BTP, métallurgie, entreprises agricoles…), puis les accords d’entreprises. Ils doivent respecter le cadre de la loi, et ne peuvent donc prévoir que des dispositions plus favorables (13e mois par exemple) ou spécifiques à leurs métiers. Des dérogations sont cependant permises depuis 1982, principalement en matière d’aménagement du temps de travail, et se sont multipliées avec la loi Fillon de 2004. Au bout de cette chaîne : le contrat de travail.
« Un accord collectif ne vaut pas contrat de travail. Il fixe les règles que doit respecter ce contrat de travail », précise Marie-Laure Morin. Suite à l’accord du 11 janvier, la logique s’inverse : un accord de maintien dans l’emploi ou une négociation sur les mobilités primeront sur le contrat que vous avez signé, y compris s’il intègre des dispositions plus défavorables. « Jusqu’à présent, malgré les possibilités de dérogations entre accords de branches et d’entreprises, on n’a jamais touché au contrat de travail », rappelle la juriste. « Le pouvoir de l’employeur s’accroît de façon déraisonnable : il n’est même plus tenu par le contrat qu’il aura lui-même signé », estime la CGT.
Front de gauche opposé, EELV très réservé
L’accord national interprofessionnel est entre les mains du ministre du Travail Michel Sapin, dont les services assurent sa retranscription. Le projet de loi sera présenté en Conseil des ministres le 6 mars, avant d’être soumis aux parlementaires. « La majorité de gauche au Parlement n’a pas été élue pour mener une politique d’inspiration aussi nettement libérale », prévient le Front de gauche. Du côté d’Europe écologie - Les Verts (EELV), le Conseil fédéral a jugé l’accord « globalement déséquilibré », même s’il marque « une relance de la négociation sociale » en berne après cinq ans de sarkozysme. « Mandat a été donné à nos parlementaires d’œuvrer pour que davantage de garanties soient mises dans la loi », précise Elise Lowy, porte-parole d’EELV et élue de la région Basse-Normandie.
Qu’en sera-t-il des députés du PS ? Accepteront-ils de légaliser cet accord en l’état ? Des voix dissidentes commencent à se faire entendre : « Avec cet accord, je vois bien la flexibilité mais pas la sécurité pour les salariés. C’est une grande simplification des procédures de licenciement », réagit Emmanuel Maurel, secrétaire national du PS, chef de file de l’aile gauche du parti (qui a obtenu 28% des voix au dernier congrès) et vice-Président de la région Île-de-France (lire notre entretien).
Dans chaque entreprise, ces dispositifs devront cependant recevoir l’aval d’une partie des syndicats locaux, selon la nouvelle loi en vigueur. « Espérons que les syndicats ne signeront pas n’importe quoi », tente de positiver Marie-Laure Morin. « Quand il n’y a plus de limites à la chasse aux coûts, il n’y a plus de compétences. Il est dommage que le gouvernement ne mette pas au premier plan la qualité du travail comme condition de la compétitivité », estime de son côté l’ergonome François Daniellou. Les deux confédérations non signataires, la CGT et Force ouvrière, rejointes par l’Union syndicale Solidaires, appellent à une journée de grève le 5 mars.
Ivan du Roy (@IvanduRoy sur twitter)
Dessins : © Rodho