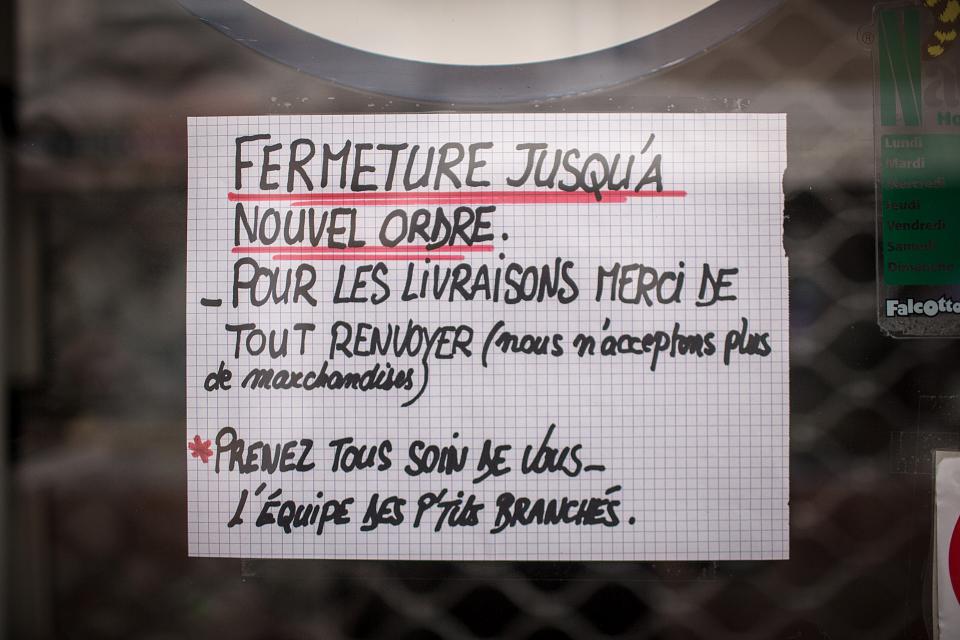Basta! : Peut-on considérer le coronavirus comme une crise d’ordre écologique ?
Jean-Baptiste Fressoz [1] : Le changement climatique et la crise environnementale sont suffisamment graves, il n’est pas nécessaire d’en rajouter. On peut évidemment dire du Covid qu’il est une « maladie de l’Anthropocène », puisque l’épidémie s’est propagée par les avions, les canaux de la mondialisation. Mais l’anthropocène est une notion tellement englobante que je ne suis pas sûr qu’on ajoute beaucoup de sens en disant cela. Je me méfie du réductionnisme climatique : j’avais été frappé en 2015 de voir les réfugiés de la guerre civile en Syrie être qualifiés par certains de « réfugiés climatiques »…
Concernant l’agriculture industrielle, il y a effectivement eu dans les années 1990-2000 des épidémies de grippes, H1N1 et H5N1, causées par l’élevage industriel – un excellent incubateur de souches de grippe de plus en plus virulentes. Pour le Covid, il semble que ce soit plutôt lié à un problème de consommation de viande sauvage, de médecine traditionnelle et de défaut d’hygiène. Bref, laissons les biologistes faire l’histoire du virus avant de dégainer l’anthropocène.
Avec la déforestation, également pointée comme un facteur aggravant, cela ne pose-t-il pas néanmoins la question d’un déséquilibre dans le rapport actuel entre humains et non-humains ?
Posé ainsi, cela me semble beaucoup trop général. Je ne crois pas qu’en ajoutant « humains/non-humains », on crée une compréhension plus fine du phénomène… Il y a même quelque chose d’un peu dépolitisant : dire que cela ressort d’un problème ontologique, c’est fascinant, mais cela reste bien vague. On s’attaque à quoi, une fois qu’on a dit ça ? Le fait que le Covid soit apparu en Chine où il est censé régner un rapport entre humains et non-humains « animiste », très différent du « naturalisme » occidental, montre bien que les modes de production n’ont pas, ou plus, grand-chose à voir avec l’anthropologie de la nature.
Ce dont on a besoin aujourd’hui, c’est d’une histoire environnementale des virus. On sait par exemple que celui du Sida a commencé à se diffuser dès les années 1920 au Congo à cause des plantations de caoutchouc, des chemins de fer, des routes [2]. Idem pour les épidémies récentes d’Ebola qui ont été mises en relation avec le développement de l’huile de palme. Pour les grippes, ce sont les usines à viande qui sont en cause. Et pour le Covid-19, c’est encore différent : une vieille question d’hygiène, et non les prémices des enjeux environnementaux du futur.
Cette crise n’a donc rien d’inédit, selon vous ?
En tant que telle, non. Ce qui est inédit, c’est qu’on a désormais les moyens techniques de sauver des vies humaines – des tests, des appareils respiratoires, la possibilité de se confiner… – et qu’émerge en conséquence l’impératif de protéger les populations. Certes le Covid-19 est plus grave que la grippe, mais certaines épidémies, y compris récentes, ont quand même fait des ravages. Durant l’hiver 1969-70, une grippe venue de Hong-Kong fait 33 000 morts en France, essentiellement des personnes âgées, dans une indifférence totale. On percevait alors cela comme un phénomène presque naturel [3].
Ce qui est ici inédit et potentiellement « historique », c’est que la plupart des gouvernements ont choisi d’arrêter l’économie pour sauver des vies. C’est une excellente nouvelle. Le Covid-19 crée ainsi un précédent : si on a pu arrêter l’économie pour sauver 200 000 personnes en France, pourquoi ne ferait-on pas demain le nécessaire pour prévenir les cancers et les 40 000 morts prématurés par an dues à la pollution ?
Qu’est-ce que cela dit de notre façon de penser le risque ?
Depuis les années 2000, un discours s’installe, d’abord aux États-Unis, pour dire qu’il faut sortir du paradigme de la prévention pour entrer dans celui de la préparation. À ce sujet, il faut lire les travaux du sociologue Andrew Lakoff, sur la preparadness, « l’impératif d’être prêt ». Sauf que, face au Covid-19, ce sont finalement des méthodes assez classiques de prévention qui peuvent nous tirer d’affaire : un grand nombre de lits hospitaliers, des personnels soignants nombreux et bien payés et une population en bonne santé. On pourra certes rétorquer que la Corée du Sud ou Taïwan ont réussi à limiter la casse grâce à d’importants stocks de tests, mais face à un phénomène épidémique qu’on ne parvient pas à contrôler, la santé publique reste la clé.
Ce point est important car émerge en ce moment un discours très technophile sur l’épidémie : le high-tech, la surveillance et la traçabilité numérique des individus relèveraient de la santé. Autrement dit, Big brother contre les virus. Pourtant, en Chine, ce sont surtout des méthodes traditionnelles qui ont été employées : quarantaine, patrouille de police avec hauts-parleurs, affiches de propagande sanitaire…
L’autre grande thèse récente sur le risque est celle d’Ulrich Beck, l’auteur de La Société du risque (1986), selon laquelle la question du risque se substituerait à la question sociale. L’enjeu central, dans les sociétés riches, ne serait plus la répartition de la production, mais la réparation des risques produits par la production. Si Beck s’est trompé en se focalisant sur la high tech – le coronavirus montre bien que les anciens risques sont toujours là – il avait raison de souligner que la gestion du risque pourrait prendre le pas sur celle de l’économie. C’est en cela que le moment actuel est fascinant, bien qu’il soit aussi probablement transitoire.
Vous ne souscrivez pas à l’idée que cette crise va profondément bouleverser l’organisation de notre système économique ?
Je ne crois pas une seconde à l’idée que « plus rien ne sera pareil après » ! Évidemment que le commerce international subit un coup d’arrêt, mais c’est temporaire. Je regardais les chiffres du commerce international après la Première Guerre mondiale : dès 1923, on retrouve le volume de 1913, après une guerre mondiale et une épidémie de grippe ayant fait 50 millions de morts. Donc oui, je me méfie de l’idée d’une « démondialisation » inéluctable.
Au sujet du CO2 et du climat par exemple, la BCE et la FED ont déjà commencé à arroser les marchés de liquidités et à renflouer les banques. On s’active pour sauver les compagnies aériennes et aider les constructeurs automobiles. En Chine, Xi Jinping a fait un grand discours, dès le 15 février, dans lequel il explique comment relancer l’économie. Il mentionne certes la santé, mais il parle aussi de lever les quotas d’achats de voiture et même de l’importance du charbon.
Vous avez plusieurs fois marqué votre désaccord avec les théories dites de la collapsologie : on est donc encore loin de l’effondrement, à vous entendre…
Si l’on veut croire à un grand basculement, cela dépend d’abord de la prise en charge politique qui sera faite de la catastrophe dans les deux ou trois années qui viennent. Or c’est justement ce que je reproche aux théories des collapsologues : de faire l’économie du politique. Penser le virus comme le symbole d’un « effondrement », c’est rater les enjeux concrets de gestion de l’épidémie, le niveau d’impréparation de la France et de l’Europe, le rôle de l’État-providence, etc. Au fond, les collapsologues ont un discours d’essence religieuse, comme si l’effondrement allait surgir de lui-même, faire table rase et laisser le terrain libre aux écolos. D’une certaine manière, l’effondrement s’est substitué à la Révolution.
La crise du coronavirus ne pourrait-elle pas, a minima, rebattre un peu les cartes du jeu politique, voire redéfinir la vraie nature du clivage politique : d’un côté, les forces progressistes et écologistes, de l’autre, les forces conservatrices et identitaires ?
Peut-être. Même si je ne sais pas trop ce qu’est un « progressiste ». D’une certaine façon, le discours de Macron indique qu’il a déjà senti le vent tourner : même le chantre des « premiers de cordée » et de la mondialisation heureuse se fait l’apologue de l’État-providence. C’est intéressant, ça peut vouloir dire qu’il pense déjà à 2022 en anticipant que l’élection se fera sur le rôle de l’État. Mais est-ce qu’il n’y avait pas déjà eu cela avec Hollande, après la crise de 2008 ? « Mon ennemi, c’est la finance », c’était bien lui, non ?
Il peut très bien y avoir une démondialisation à la marge : mettre fin à la sous-traitance de la production de masques ou des principes actifs nécessaires pour les tests et remettre sur le territoire des usines capable d’en produire. C’est tout à fait mineur dans l’économie. Entre la souveraineté stratégique en matière pharmaceutique et une démondialisation à la hauteur de l’enjeu climatique, il y a quand même un gouffre gigantesque ! De même on va sans doute voir s’accentuer les plans de relance « verts », et autres « green new deal ». C’est intéressant, mais le problème avec les investissements verts, c’est qu’ils s’ajoutent à une « infrastructure brune » : ils ne produisent qu’une « addition énergétique », et non une véritable transition. Acceptera-t-on de se passer des biens high tech et bon marché venus d’Asie ? De se passer des hectares fantômes du Brésil, d’Indonésie ou d’Argentine [terres utilisées pour produire quasi exclusivement des produits consommés ailleurs, en Europe, en Amérique du Nord ou en Chine, comme le soja ou l’huile de palme, ndlr] ? Va-t-on renationaliser les banques pour les obliger à se désinvestir du gaz et du pétrole ? Est-ce qu’un État actionnaire serait capable de prendre de telles décisions, de reconvertir Airbus et l’industrie automobile ? L’enjeu est là, bien sûr : mettre à profit cette crise globale majeure pour engager une véritable transition.
Recueilli par Barnabé Binctin
Photo : Pedro Brito Da Fonseca
– « Pour Emmanuel Macron, tout l’enjeu consiste à sauver le capitalisme sanitaire et ses grandes industries », avec le sociologue de la santé publique Pierre-André Juven.
– « En matière d’information scientifique, la gestion de la crise actuelle a été un fiasco », avec l’historien des sciences biologiques Laurent-Henri Vignaud.
– Et sur la question de l’effondrement : « Nous sommes en train de vivre une mosaïque d’effondrements » : la fin annoncée de la civilisation industrielle, avec Pablo Servigne et Raphaël Stevens, auteurs de « Comment tout peut s’effondrer »