Basta! : Quels ont été les principaux apports des mouvements sociaux et du mouvement ouvrier à la société française telle qu’elle est aujourd’hui ?
Danielle Tartakowsky [1] : La France de l’après-guerre a connu, comme nombre de pays, la mise en place d’un État providence – ou d’un État social s’agissant de la France. En Europe, le keynésianisme apparaît alors comme la réponse pour réorganiser le capitalisme entré en crise dans les années 30. En France, cet État social, aujourd’hui mis à mal, présente la caractéristique d’être non seulement le fruit d’une conjoncture mais aussi le résultat d’une étroite connexion avec le mouvement social. Les mobilisations populaires qui se déroulent entre 1934 et 1946 impriment leurs marques dans la nouvelle forme de compromis social qui sera mise en œuvre après la Libération. Ces mobilisations populaires prennent deux formes : la grande mobilisation de 1934, qui commence sur des bases antifascistes [2], se poursuit avec les grandes grèves du Front populaire. Et débouche sur l’élaboration des conventions collectives, les congés payés et la semaine de 40 h. Cette mobilisation se prolonge dans la Résistance et donne naissance au programme du Conseil national de la résistance (CNR), qui posera, à la Libération, les bases de la Sécurité sociale.
Cette spécificité française, le fait que l’État social se construise en étroite connexion avec ces mouvements populaires, explique la très grande capacité de mobilisations et de réaction face aux premières attaques contre cet État social. Ces mobilisations s’expriment encore par à-coups dans les années 90, même si elles se construisent sur des bases plus défensives, contre les coups de boutoirs donnés à ce qui reste encore du compromis social. Nous connaissons aujourd’hui l’épuisement du phénomène, la fin d’un cycle hérité de ces grands mouvements.
La crise économique actuelle n’est-elle pas censée provoquer un sursaut, comme en Grèce ?
Tous les historiens de la grève et les sociologues du travail montrent que ce sont les phases de croissance qui génèrent une poussée de grèves, pas les périodes de crise. La crise économique et financière qui survient en 1929 n’était pas porteuse de luttes. Le nombre de grèves, qui était déjà bas avant, diminue encore. Alors que la crise est là, de 1931 à 1934, il ne se passe presque rien : une grève chez Citroën et des marches de chômeurs. Celles-ci n’ont cependant rien à voir avec l’ampleur de ces marches aux États-Unis ou en Grande-Bretagne.
Aujourd’hui, nous sommes dans une situation économique qui laisse peu d’espoir à une issue rapide des revendications. La grève, dans un contexte de chômage massif, est évidemment difficile à mener. Les formes d’organisation du travail sont un facteur puissant de destruction des collectifs, et donc des forces de la mobilisation. Les luttes qui se mènent sont souvent celles du désespoir, contre des fermetures d’usines. C’est quand il n’y a plus d’issues que s’installent de longues grèves. Et la plupart du temps, elles n’empêchent pas les plans sociaux. Sans issue politique à court terme, il y a le sentiment que rien ne permet de modifier radicalement l’état des choses. De ce point de vue, la situation grecque n’incite pas à l’optimisme. Certes Syriza est au pouvoir, mais le complexe rapport de force va nécessiter de passer des compromis.
Comment passe-t-on de luttes et de mouvements sociaux épars à une mobilisation capable de forger un nouveau modèle économique et social, comme ce qui s’est produit pour la construction d’État social, en France, à la Libération ?
Dans la période qui suit la Première guerre mondiale, il y a bien l’idée que la révolution est pour demain [La révolution russe a eu lieu en 1917, et une tentative de révolution socialiste échoue en Allemagne début 1919, ndlr]. En France, « la phase de stabilisation » du capitalisme consacre la mise en place d’un État très libéral. La faible irruption des pouvoirs publics dans le domaine social ne crée pas d’espace pour des luttes globalisantes. Quelques grèves sectorielles sont menées, dans le textile notamment, sur les salaires ou le temps de travail. Les mouvements sont cependant très éclatés. Les quelques tentatives de grève politique de masse, souvent liées à des évènements internationaux, ne débouchent sur rien. A la fin des années 20, le mouvement communiste, et notamment à la CGT, estime que le capitalisme et l’impérialisme sont entrés en crise, que cette crise provoquera une radicalisation des masses, et que de cette radicalisation naîtra la révolution. Ce qui ne se produira pas.
En 1934, il y a une mobilisation politique parce qu’un ennemi, le fascisme, menace. Cette mobilisation construit une puissance en acte. Forces syndicales, associatives et politiques descendent dans la rue sur des bases antifascistes. Une fois dans la rue, elles y restent et se mobilisent sur autre chose : ce sont les grèves de 1936 et le Front populaire. La construction du nombre et d’un espoir créent la force d’accomplir quelque chose d’inédit. Gardons-nous de faire de 1936 ou du programme du CNR un modèle pour aujourd’hui. Il est cependant intéressant de souligner que, dans ces moments historiques, les parties prenantes sont à la fois des partis, des syndicats, des associations, et des mouvements de résistance dans le cas du CNR.
Idéalement, il faudrait aboutir à ce que les acteurs en mouvement, quels que soient leurs modes d’organisations, parviennent à construire à un nouveau modèle du vivre ensemble et du développement. Dans des conjonctures où quelque chose permet de créer du sens commun, des acteurs extrêmement éloignés des uns des autres – en terme idéologique, de générations d’organisations ou de projets – peuvent parvenir à construire ensemble. Mais cela ne se décrète pas. Il y a, aujourd’hui, nombre de forces qui sont dormantes. Si un espace s’ouvre, elles peuvent se remobiliser.
Le syndicalisme en fait-il partie ?
On fait porter une lourde responsabilité aux syndicats. Même s’ils sont en difficulté, ils constituent quand même le dernier pôle de résistance. Il n’y a pas eu en France de grande mobilisation sans que le mouvement syndical en soit la base logistique, y compris sur des questions éminemment politiques. Dans le cadre de l’État social, le mouvement syndical a beaucoup travaillé en articulation avec les stratégies politiques. Quand ces relais politiques n’existent plus, comment passe-t-on d’une mobilisation sur des revendications déjà difficiles à résoudre, à des questions plus globales ?
Mouvement social et mouvement ouvrier ont été largement inspirés par les courants de pensées socialistes et du christianisme social. Ces courants de pensées sont-ils en voie de disparition ? Quelle est la place pour d’autres influences, comme l’écologie ?
Des générations de militants qui ont participé à ces mouvements sont encore actives. Le meilleur exemple c’est le travail qui a été fait sur le Forum social européen de Paris - Saint-Denis en 2003 où la sociologie des participants révèle le poids des militants classiques appartenant aux deux grandes branches que vous évoquez. Et donc la relative faiblesse de nouveaux acteurs. Mais les cultures politiques circulent de manière souterraine. L’émergence de quantité de formes de luttes et d’acteurs montre qu’il y a un potentiel. Mais aussi un effritement : chaque grand mouvement, comme celui des chômeurs en 1997, génère ses propres structures qui, ensuite, s’auto-entretiennent [3]. Cela peut être vu comme une dynamique ou comme un frein.
Les modes d’organisation et d’expression des luttes ne sont pas de même nature que pendant les 50 dernières années. Les mouvements sociaux qui nous servent de référence aujourd’hui, sont finalement actifs sur une période historique relativement courte : elle s’ouvre en 1947 et se termine en 1995, avec la grande grève sur les retraites. Il n’existe pas, pour le moment, de construction de grands modèles. Le rapport au global n’est pas le même. Les stratégies des mouvements font débat : faut-il penser l’unité de ces luttes – comme le suggèrent le philosophe italien Toni Negri, et son concept de « multitude », ou le français Alain Badiou ? Ou au contraire ne plus tenter de globaliser, toute tentative de le faire étant vaine quand, estiment certains, ce sont des « réseaux » qui participent à la construction de quelque chose de neuf. Les anciennes formes de lutte n’ont pas disparu, mais nous sommes dans une phase de grande redéfinition. L’écologie est sans doute l’une des tentatives les plus abouties de penser ce qui devrait – ou pourrait – unifier nombre de mouvements, face à « la société du risque », liée au développement industriel et technologique, et théorisée par le sociologue allemand Ulrich Beck.
Les droites extrêmes tentent de récupérer certains symboles et modes d’actions du répertoire de gauche – manif pour tous, mise en avant par le FN de militants venus du monde syndical… Est-ce nouveau ?
Après 1934 et jusqu’en 1968, tant que dure l’État social, les forces qui se mobilisent et manifestent se trouvent à la gauche de l’échiquier politique. Les droites ont quasiment disparu des espaces publics. Elles manifestent sous la forme de mouvements anti-fiscaux, portés par des classes moyennes non salariées, les mouvements d’artisans et de commerçants de Pierre Poujade ou de Gérard Nicoud. Avec la fin de l’État social, on redécouvre que des forces situées à la droite de l’échiquier sont susceptibles de se mobiliser puissamment : en 1984, la grande manifestation contre la loi Savary sur l’école, et plus récemment la « manif pour tous », les « jours de colère » ou les bonnets rouges. Depuis une petite décennie, les dynamiques de mobilisation sont beaucoup plus puissantes à droite qu’à gauche. Il existe une forte tradition de mobilisation chez les catholiques. Aujourd’hui encore, en France, les deux forces capables de générer de grands mouvements sociaux dépassant les cadres militants et produisant des effets imprévisibles sont, à droite, les catholiques et, à gauche, le mouvement syndical.
Les nouveaux médias et technologies d’information jouent-ils un rôle dans l’émergence de nouveaux mouvements sociaux ?
La réponse politiquement correcte est oui. Pour des luttes qui se développent dans une conjoncture favorable, voire même se terminent par des victoires, l’existence de nouveaux médias est un facteur qui favorise la mobilisation. Dans des situations difficiles ou perdues d’avance, cela ne change rien. Ces médias facilitent l’information autant que la désinformation ! Ils jouent un rôle, mais ne se substituent pas aux autres formes d’organisations. Une pétition sur Internet n’est pas l’équivalent d’une manifestation. C’est le rapport de l’individu au collectif qui se trouve modifié. Les nouveaux médias sont un moyen d’agréger des individus, mais ce n’est pas en agrégeant des individus pour faire nombre que l’on crée forcément du collectif.
Recueilli par Ivan du Roy
Photo : Manifestations contre des grands projets inutiles et polluants, à Valparaiso, Chili, 21 Mai 2011 / CC Davidlohr Bueso
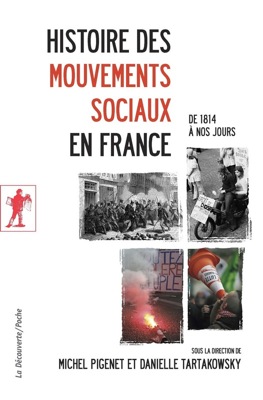
A lire : Histoire des mouvements sociaux en France, de 1814 à nos jours, sous la direction de Michel Pigenet et Danielle Tartakowsky, Ed. La Découverte, novembre 2012.








