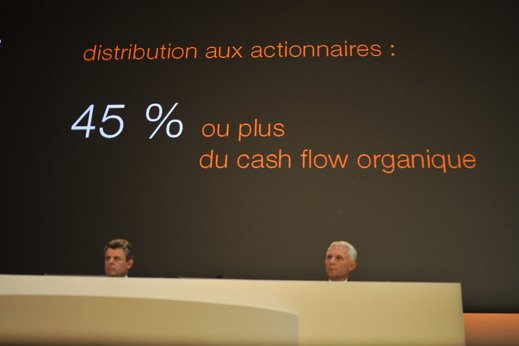Depuis qu’elle a quinze ans, Estelle Becker Costanzo travaille dans les restaurants de Pittsburgh (Pennsylvanie). Aujourd’hui, âgée de 56 ans, elle est serveuse au restaurant Capital Grille, un emploi dont elle est fière. « C’est un bon job », explique-t-elle… par comparaison avec le reste du secteur. Son salaire horaire de base est cependant bloqué à 2,83 dollars (2,5 euros) depuis 25 ans. Elle a du mal à couvrir ses dépenses les plus basiques. « Initialement, les pourboires étaient censés représenter 50% de notre paie. Maintenant, c’est plutôt de l’ordre de 100%. » À mesure que les pourboires deviennent sa source principale de revenus, elle se trouve fragilisée. « La retraite ? Je vais devoir travailler jusqu’à 80 ans, dit-elle. On ne pense pas vraiment à l’avenir avant qu’il finisse par vous sauter au visage. »
« C’est toujours dix-sept heures par jour »
À Toronto, Kristy Milland pense beaucoup à l’avenir. Tout comme Estelle, son revenu a longtemps dépendu du bon vouloir des gens qu’elle sert. Sauf qu’elle ne travaillait pas dans des restaurants, et ne recevait pas de pourboires. Pendant des années, elle n’a pas rencontré un seul de ses nombreux clients. Kristy Milland fait partie du demi-million de personnes qui travailleraient actuellement pour le Mechanical Turk (MTurk) de l’entreprise Amazon, l’un des principaux employeurs de l’économie précarisée. Une économie basée sur des plateformes en réseaux comme Uber ou Handy, qui relient des travailleurs à des employeurs, petit boulot par petit boulot.
Les « turkers », comme ils s’appellent eux-mêmes, sont mis en relation avec des « demandeurs », des employeurs qui proposent une rémunération fixe en échange d’une tâche spécifique. Amazon vante les turkers comme une forme d’« intelligence artificielle artificielle », capable de réaliser avec brio des tâches pour lesquelles les ordinateurs ne sont pas aussi adaptés : transcrire des enregistrements audio, catégoriser des images, ou servir de cobayes dans des expérimentations universitaires. Les rémunérations se comptent en dollars ou en centimes, pour des jobs qui peuvent prendre quelques secondes ou plusieurs heures. Même si les salaires sont modestes, la concurrence peut être féroce. « Parfois je reçois un texto au milieu de la nuit et je sors de mon lit pour commencer », raconte Kristy Milland. Pour gagner un salaire journalier convenable, elle se retrouve parfois à travailler dix-sept heures d’affilée. À d’autres moments, elle passe une semaine sans travailler. Ce qui ne veut pas dire que c’est une semaine de vacances : « C’est toujours dix-sept heures par jour, mais dix-sept heures à chercher du travail. »
Même lorsque le travail est régulier, Kristy n’est pas certaine d’être payée. Les demandeurs peuvent refuser un travail sans explication, et avec des conséquences minimales, puisqu’un autre turker sera disponible, souvent en quelques secondes, pour reprendre le job.
« Nous sommes déjà nombreux dans le monde du travail du futur »
Ce qui relie les travailleurs de l’économie des petits boulots « ubérisés » – la gig economy, comme on l’appelle aux États-Unis – comme Kristy Milland et les employés rémunérés au pourboire comme Estelle Becker Costanzo, c’est la précarité de leur situation de travail. Leur revenu, leur quantité de travail, et leur capacité à assurer leur besoins fondamentaux ne sont pas sécurisés, et de moins en moins protégés. Cette insécurité s’alimente elle-même. Les travailleurs obnubilés par le besoin de trouver – et garder – du travail ne sont pas toujours les plus disposés à revendiquer de meilleures conditions.
Lorsque Rochelle LaPlante, modératrice d’un forum de discussion pour turkers du nom de « MTurk Crowd », a publiquement critiqué la plateforme d’Amazon, elle s’est retrouvée confrontée à un flot de récriminations… de la part d’autres turkers. Certains membres de son forum auraient préféré qu’elle se taise. En privé, ils craignent que les demandeurs ne quittent la plateforme si leur mauvais traitement des travailleurs est mis en lumière. D’autres ont peur de représailles plus directes : LaPlante raconte que le compte d’au moins une personne s’est trouvé suspendu indéfiniment après qu’elle ait évoqué publiquement les mauvaises conditions de travail. Ce type de représailles à l’égard d’employés est explicitement interdite par la loi, mais comme le travail effectué par les turkers est considéré comme du travail indépendant, l’entreprise n’obéit pas à ces dispositions du droit du travail.
Pour Kristy Milland, ces plate-formes nous destinent à plus ou moins brève échéance à une précarité généralisée : « Enseignants, docteurs, avocats, comptables, programmeurs, designers, auteurs, journalistes – nous irons tous sur une plateforme chaque matin, où nous chercherons du boulot dix-sept heures par jour. Nous sommes déjà nombreux à opérer dans le monde du travail du futur, et les nouvelles ne sont pas bonnes. »
Micro-entrepreneuriat et travail flexible
Pour les propriétaires de plateformes, la précarité est un élément central de l’avenir qu’ils sont en train de bâtir. Dans une lettre ouverte à la Commission européenne, un consortium de 47 entreprises gérant de telles plateformes plaide contre la régulation de leur industrie. Elles se décrivent comme des « innovatrices » qui « remodèlent les chaînes de valeur de fond en comble ». Aux Kristy Milland de ce monde, ils promettent « de nouvelles sources de revenu, le micro-entrepreneuriat, et le travail flexible ». En d’autre termes : toujours plus de précarité, et une précarité toujours plus profonde.
Mais l’époque recèle un paradoxe : les technologies qui permettent de saper les formes de travail traditionnelles rendent également possibles de nouvelles formes d’émancipation. « Ce que nous faisons au fond, c’est en partie d’élargir l’horizon de ce qui est possible », explique Michelle Miller, co-fondatrice de CoWorker, une plateforme pour les travailleurs qui cherchent à lancer des campagnes de revendication. Les usagers types de CoWorker sont des employés de grandes entreprises ou de chaînes qui, comme les turkers, sont isolés à la fois de leurs employeurs et les uns des autres. Ils ne sont généralement pas syndiqués. Et même lorsqu’ils disposent de syndicats, ils ne peuvent pas mener toutes les batailles. Ils consacrent leurs ressources aux campagnes qui ont les plus grandes chances de succès. Certains problèmes importants sont ainsi laissés de côté.
De nouvelles formes de lutte, et leurs limites
CoWorker a été lancé sur une idée simple : que les travailleurs se prennent en main. Les outils qu’il propose permettent à des gens comme Estelle Becker Costanzo de lancer leurs propres campagnes de revendication et de construire des réseaux en ligne pour rompre l’isolement. Parmi les milliers de personnes qui ont apporté leur soutien à la campagne lancée par Estelle, pour l’amélioration du salaire horaire fixe, se trouvent des dizaines d’employés de la même chaîne de restauration, issus de villes de tout le pays.
La co-fondatrice Michelle Miller estime que ces initiatives, qui mettent à profit les réseaux numériques pour regagner des protections perdues, sont cruciales. « Nous sommes dans une situation où nous devons récupérer des droits que nous avons perdus », explique-t-elle. Mais le chemin à parcourir reste important. « Notre culture et notre économie ont renforcé depuis des années l’idée selon laquelle, au travail, il faut prendre ce que l’on nous donne. On a “déjà de la chance” d’avoir un travail. » Quand il faut lutter ne serait-ce que pour maintenir le statu quo, il y a peu d’espoir d’obtenir une amélioration radicale de ses conditions de travail.
Estelle Becker Costanzo est du même avis. Elle sait que la campagne qu’elle mène est importante, mais est conscience de ses limites. « Je ne sais pas trop de quels recours nous disposons à ce stade, dit-elle. Davantage d’attention des médias ? Nous lançons cette initiative, mais ensuite cela stagne. Nous devons devenir plus fort et faire plus de bruit, sinon nous allons disparaître des écrans radar. Quelqu’un doit passer à l’échelle supérieure. »
Traiter les personnes comme des algorithmes
Mais comment les travailleurs des petits boulots numériques peuvent-ils devenir des « participants actifs » si leur lien de travail est virtuel ? Turkopticon se veut une réponse à ce problème. Le service, mis en place par Lilly Irania, professeure assistante à l’université de Californie à San Diego, et Six Silberman, un chercheur et développeur, permet collectivement aux turkers de suivre à la trace les demandeurs. Parfaitement articulée à l’interface de MTurk, elle permet aux travailleurs de savoir si leurs pairs ont signalé un demandeur ayant rejeté un travail valide. Les turkers peuvent ainsi créer un frein à leur propre précarité : le déni de salaire et les abus à leur égard ne restent pas sans conséquences. Ils agissent sans passer par les propriétaires de la plateforme, et sans attendre que les autorités décident d’intervenir. Avec Turkopticon, beaucoup de turkers ont réalisé leur capacité à se défendre.
Pour des luttes de plus grande envergure, ils auront cependant besoin de davantage de cohésion. Les turkers parviennent facilement à collaborer via Turkopticon, mais toute perspective de coordination à plus grande échelle est entravée par le caractère isolé et fracturé de leur communauté.
« Dynamo est un lieu pour se réunir », explique Kristy Milland. Cet autre forum permet aux turkers de choisir des actions à mener collectivement. J’ai rencontré Niloufar Salehi, la cheville ouvrière de Dynamo. C’est une étudiante en troisième année de thèse d’informatique à l’université de Stanford. Au cœur de la Silicon Valley, au milieu de ses pairs qui développent les algorithmes permettant de faire fonctionner les plateformes de services générant la précarité, Niloufar Salehi cultive sa singularité. Pour elle, traiter les personnes comme des algorithmes étouffe la plus grande part de notre humanité. Niloufar Salehi a visité des forums de turkers pour comprendre leurs besoins. Les propositions d’action de Dynamo sont ainsi limitées à un seul message de la longueur d’un « tweet », et la participation peut se limiter à un simple vote, pour ou contre. La communauté demeure ainsi structurellement ouverte.
« Il nous faut des plateformes gérées par les travailleurs eux-mêmes »
Ce qui encourage les turkers à ne pas renoncer, c’est qu’ils n’ont pas d’autre option. Pour des raisons médicales et avec ses responsabilités familiales, explique Kristy Milland, elle ne peut pas avoir de job à temps plein. Elle estime qu’il en va de même pour la grande majorité des turkers, et LaPlante est du même avis : « Certains s’occupent d’enfants ou de parents âgés chez eux. Certains ne peuvent pas trouver de travail dans la zone rurale où ils habitent. Certains ont un casier judiciaire. Certains n’ont pas de moyen de transport. »
Tout comme comme elles, nombre de turkers espèrent que les communautés décentralisées et inclusives qu’ils s’efforcent de construire peuvent déboucher sur quelque chose d’entièrement nouveau, quelque chose qui soit en phase avec leurs principes. Kristy Milland a un objectif très clair en tête : « Il nous faut des plateformes gérées par les travailleurs eux-mêmes. »
Trebor Scholz, professeur associé à la New School de New York, spécialiste de la culture et des médias, partage cette vision. Pour lui, les plateformes de services révèlent une lacune fondamentale dans la manière dont nous mesurons le progrès. « Comment quelque chose peut-il être considéré comme de l’innovation si cela ne bénéficie qu’à une cinquantaine de personnes dans la Silicon Valley ? », demande-t-il. Il considère le déplacement du travail vers ce type de plateformes comme une opportunité pour construire de nouveaux services, qui ne soient pas la propriété seulement de leurs concepteurs, mais de tous leurs usagers. La propriété, rappelle-t-il, implique « davantage de contrôle ». Ces plateformes coopératives tendraient à mieux traiter les travailleurs, les territoires, et à générer une richesse partagée.
Mettre les coopératives en réseau, peser sur les décideurs
L’idée rejoint celle des traditionnelles coopératives de travailleurs, qui peuvent rencontrer un certain succès lorsqu’elles sont protégées – par la géographie, les régulations ou la culture – de la concurrence des grandes entreprises. Plusieurs coopératives de taxis ont ainsi existé dans certaines villes américaines pendant des décennies. Mais, si elles parviennent à se tailler un marché de niche local, elles ne sauraient prétendre aux mêmes ressources et à la même visibilité qu’une plateforme globalisée comme Uber.
Du moins, pas toutes seules. Fonctionner sur la base de plateformes, pour des coopératives, permet de gagner en envergure sans remettre en cause la propriété des travailleurs. Arcade City en donne un exemple. La structure propose de se débarrasser des intermédiaires et de connecter directement chauffeurs et usagers à travers une seule application coopérative, propriété collective de ses membres.
En plus de diffuser les exemples de réussites de ce type, l’objectif de Trebor Scholz est de connecter entre elles différentes formes de coopératives pour former une communauté en réseau, un écosystème au sein duquel des coopératives alimentaires peuvent collaborer avec des startups et avec des réseaux sociaux coopératifs. Cette mise en réseau doit participer d’un mouvement politique suffisamment organisé pour exercer une influence collective sur les régulateurs et les législateurs. Dans la vision de Trebor Scholz, cela implique un type d’économie totalement différent, où les ressources sont distribuées et partagées via des plateformes présentes sur les marchés, mais qui fonctionnent également comme pare-feu, en apportant des garanties mutuelles de soutien matériel. Par exemple, les travailleurs d’une plateforme coopérative de jobs ponctuels pourraient obtenir des part dans une coopérative d’alimentation. Chacun serait propriétaire, et les bienfaits de l’innovation seraient ainsi partagés.
Une possibilité de connectivité sans précédent
L’économie des petits boulots « ubérisés » est souvent vue comme l’avenir dystopique du travail. Mais il n’y a pas grand-chose de nouveau dans le modèle commercial sous-jacent. Ce qui est nouveau, c’est que le réseau social qui rend possible la dynamique actuelle de dépossession donne en même temps aux travailleurs une connectivité et une portée sans précédent. Le fait d’être connecté, à lui seul, ne va pas apporter de changement révolutionnaire ; mais les mouvements peuvent se coordonner, et se développer à une échelle inédite tout en restant inclusifs et démocratiques.
CoWorker et Dynamo sont deux exemples précurseurs de construction de communautés en réseau, démocratiques, gérées par les travailleurs eux-mêmes. Actuellement, ils sont surtout utilisés pour des campagnes très spécifiques, mais pour la co-fondatrice de CoWorker Michelle Miller, il s’agit d’un marchepied vers de nouvelles façons de travailler collectivement : « Je pense que l’internet n’est pas un ensemble d’outils… C’est un lieu et une culture. Il nous oblige à nous comporter différemment. Et si nous parvenons à le faire, nous pouvons faire des choses étonnantes. »
Les réseaux émergents de travailleurs qui se soutiennent mutuellement grâce à ces outils pourraient être parmi les premiers à adopter ces nouvelles plateformes coopératives. Quels genres de services pourraient fleurir à partir de ces plateformes ? Peuvent-ils contribuer à construire une nouvelle économie ? Ce sont des questions auxquelles on ne peut répondre que par la pratique. « À quoi cela va-t-il ressembler si nous commençons à bâtir aujourd’hui ? Je ne sais pas. Mais nous devons essayer », conclut Kristy Milland.
Paul Hampton
Cet article a été publié initialement en anglais par Yes ! Magazine. Traduction : Susanna Gendall pour Basta!. Afin de faciliter la lecture, quelques coupes ont été réalisées par rapport à la version originale.
—
Photo : Henry Faber